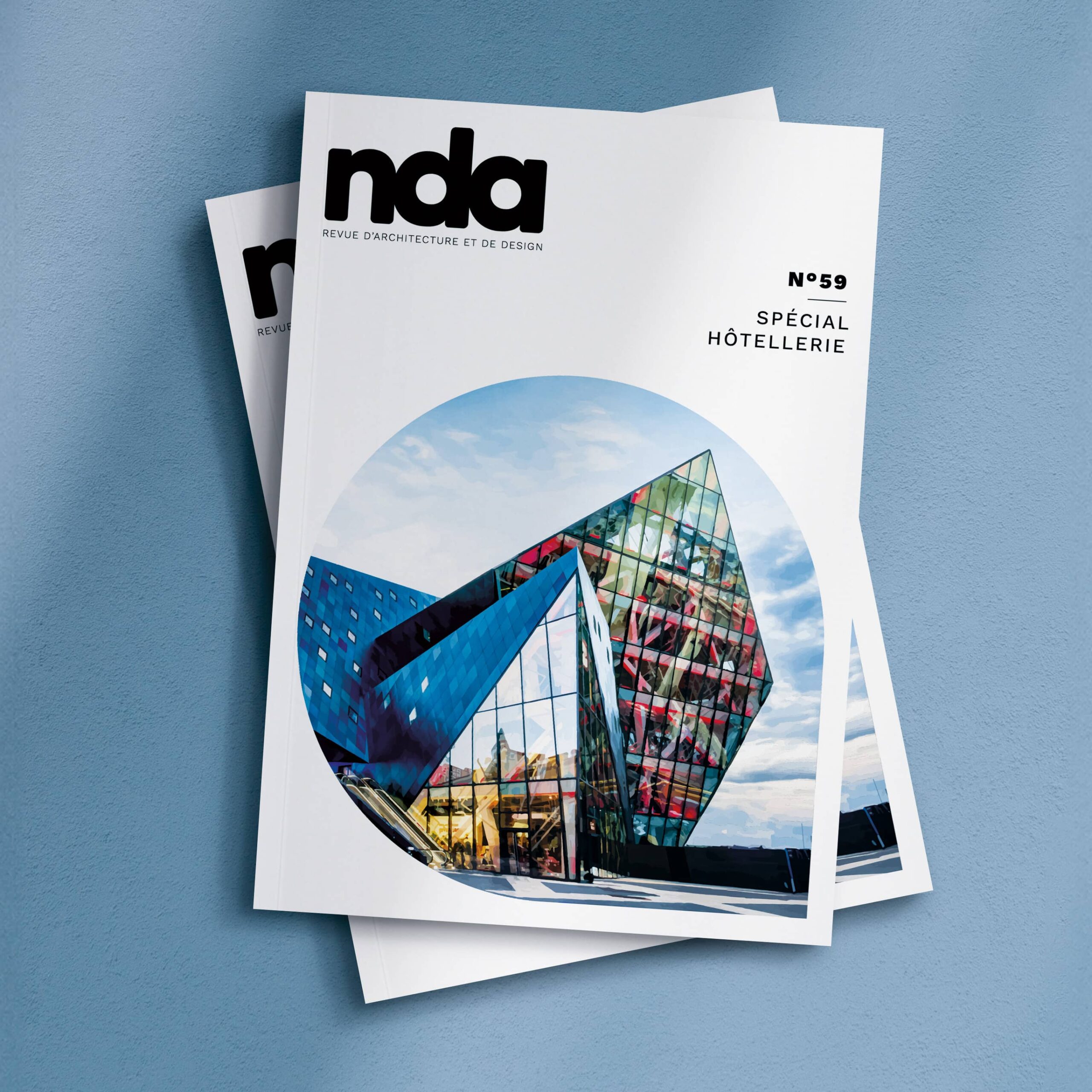Invitation œnotouristique

Chevalier de la Légion d’honneur, primée de la mention spéciale du Prix Femmes Architectes 2022 pour l’ensemble de sa carrière, académicienne d’architecture, fondatrice de la fédération des concepteurs d’expositions XPO, membre titulaire du Haut Conseil des musées de France… Adeline Rispal a plus d’une corde à son arc.
Adeline Rispal.
Adeline Rispal est mondialement connue pour concevoir des projets culturels et patrimoniaux exceptionnels. Cette architecte scénographe vient de livrer en plus du Musée savoisien et du Centre national du costume et de la scène, Les Cités des climats et vins de Bourgogne à Chablis et Mâcon.
L’agence Ateliers Adeline Rispal a remporté les deux concours de maîtrise d’œuvre scénographique séparés pour les Cités de Mâcon et de Chablis. Ces projets sont à l’initiative du BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne), propriétaire des sites, dont la maîtrise d’œuvre d’architecture est signée l’Atelier Correia Architectes et Associés pour Chablis, et RBC Architecture associé à ACL Architecte pour Mâcon.
Mise en scène des lieux.
Pour ces deux projets, Adeline Rispal a conçu une scénographie différente. Toutefois, ils ont en commun la place de l’usager, qui est mis au cœur du concept. Les Cités des climats et vins de Bourgogne ont pour objectifs de devenir des lieux de référence pour néophytes et passionnés, de faire découvrir à travers des expériences conviviales, sensorielles et pédagogiques le vignoble travaillé par l’homme.
Le « climat » est une notion bourguignonne qui évoque une parcelle de vigne délimitée depuis des siècles (la plus ancienne datant de 630), avec les caractéristiques s’y référant (sol, cépage, altitude…). Il est à noter que la Bourgogne compte 1 200 climats.
Adeline Rispal a conçu sa scénographie sur trois fondements pour offrir une expérience singulière. Pour elle, le visiteur doit éprouver en ressentant pour connaître par l’expérience, comprendre en exprimant et partageant ses émotions, déguster en appréciant les saveurs et en éduquant son goût.
- © ATELIERS ADELINE RISPAL, Photo Luc Boegly
- © ATELIERS ADELINE RISPAL, Photo Luc Boegly
- © ATELIERS ADELINE RISPAL, Photo Luc Boegly
Des strates pour structurer et ressentir.
Le fil rouge des scénographies des lieux est le concept de strates géo-sensorielles. Trois sortes de strates sont pensées. Elles créent des univers pour plonger le visiteur en totale immersion. Les strates permettent de concevoir des ambiances spécifiques selon les matériaux (roche, bois, végétaux…) mais aussi avec tous les outils technologiques (multimédia, numérique, signalétique, didactique, éclairage…).
Immersion avec les cinq sens.
Les cinq sens interviennent lors des visites des Cités. On vit les choses. Le parcours est ponctué de contenus audiovisuels sur le travail de la vigne, l’art de la vinification, les traditions, la culture, la tonnellerie… et avec des témoignages de vignerons.
S’éduquer au goût par les mots.
L’histoire du patrimoine des climats est interprété aussi avec des mots. Un univers poétique et émotionnel est exprimé au travers Jean-Pierre Garcia, Bernard Pivot et Jacques Puisais.
Une attention particulière est portée au graphisme. La signalétique est travaillée dans les tons du parcours pour les adultes, et pour les enfants elle est plus ludique. Trois langues : français, anglais et allemand.
Entendre.
L’ouïe tient une part importante dans le projet. Les sons apaisent et permettent de mieux ressentir la vie des terroirs. Une création sonore est imaginée dans tous les espaces. Elle est synchronisée. Selon l’endroit où l’on est, le son s’atténue ou s’intensifie. On entend des bruitages liés aux métiers mais aussi le clocher retentir près de la maquette interactive. Aucune cacophonie. Tout est dans le tempo, aucune fausse note dans le mix de bruitages et de compositions musicales. Les strates sonores se complètent et s’harmonisent.
Place aux enfants.
Un parcours est pensé pour les plus jeunes. On ponctue les lieux de petites cachettes dissimulées dans les strates. Les enfants apprennent en s’amusant. Ils découvrent l’histoire de la vigne avec les fossiles, les abris dans les vignobles appelés les cabottes, les animaux… À la sortie, ils finissent par la dégustation d’un jus de raisin.
Le site de Chablis.
Dans le cellier historique du Petit Pontigny, qui appartenait aux moines cisterciens (XIIe siècle), l’exposition a une superficie de 300 m2. L’Atelier Correia Architectes et Associés a réalisé une extension contemporaine de verre, de bois et de béton de terre afin de garder le côté historique. La nouvelle aile se dissocie de l’ancien édifice autour d’un jardin intérieur.
La scénographie se marie avec les strates du jardin, conjuguant ainsi l’extérieur avec l’intérieur. Les voûtes de pierre conservées sont valorisées par les mises en scène horizontales à 1,90 m du sol. Un espace en double hauteur dynamise les lieux.
- © ATELIERS ADELINE RISPAL, Photo Luc Boegly
- © ATELIERS ADELINE RISPAL, Photo Luc Boegly
- © ATELIERS ADELINE RISPAL, Photo Luc Boegly
Le site de Mâcon.
La Cité de Mâcon est dans un bâtiment hybride des années 1950 en bord de Saône à proximité du centre historique. L’extension signée RBC Architecture et ACL Architecte dote l’édifice d’un belvédère contemporain de 7 mètres en forme de vis de pressoir. Le site avec cette architecture devient un repère dans la ville.
La superficie du parcours est de 350 m2. Le parcours se prolonge jusque dans le hall. La scénographie des strates se traduit en cercles concentriques dans la boutique, les espaces annexes et l’accueil. Afin de simuler les variations de la météo, un lustre magistral joue avec les intensités et couleurs.
En entrant, les strates horizontales de films composent une mosaïque de vues ou alors une grande image. Elles s’insèrent entre les murs historiques. Une grande maquette interactive blanche représente les territoires des Cités. À 80 cm de hauteur, elle permet une parfaite lisibilité et est accessible à tous. Sur la maquette, des projections soulignent les facteurs naturels mis en valeur par l’homme au fil du temps. Un système interactif tactile permet au visiteur doté d’un bracelet connecté de lancer des séquences animées en s’approchant de telle ou telle zone. À la fin de sa visite, selon ses interactions et déplacements, on lui donne son profil d’amateur de vin de Bourgogne.
- © ATELIERS ADELINE RISPAL, Photo Luc Boegly
- © ATELIERS ADELINE RISPAL, Photo Luc Boegly
- © ATELIERS ADELINE RISPAL, Photo Luc Boegly
Une cave aux arômes.
L’espace composé de sphères en verre sur une table permet de humer et gouter les vins.
Travail sur l’éclairage.
La lumière tient une part importante dans la scénographie. Le parcours commence dans la pénombre. Des points lumineux, discrets et intensifs servent de repères dans l’espace autour des écrans. La luminosité guide les visiteurs. Dans la cave aux arômes, l’éclairage accentue le nectar.
Le choix des technologies de l’éclairage ont pris en compte la durabilité, leur consommation énergétique et leur maintenance. Les luminaires sont à LED à haut rendu de couleurs (norme TM30-15). Des sources ponctuelles sont intégrées à l’architecture et aux mobiliers d’exposition. Le concept d’éclairage est piloté dans l’ensemble sur une tablette mobile.
Des espaces publics.
À la fin du parcours, une plateforme œnotouristique présente l’offre complète du territoire. Un questionnaire permet d’orienter les visiteurs pour découvrir la région. Une boutique est conçue dans l’esprit du musée avec des strates. On y trouve des comptoirs d’accueil, une librairie, des produits… Elle dispose de grands volumes qui favorisent les rangements et le stockage. Un espace de dégustation invite les visiteurs dans un cadre plus chaleureux car les strates sont en bois. Les lieux dotés de grandes tables hautes, d’espaces lounge… sont conviviaux et pensés pour tous publics.
Un travail titanesque a été pensé et effectué dans les moindres détails pour ces deux adresses.
Le prix international de design, The Muse Design Awards, fondé à New-York en 2015, est l’un des prix les plus influents dans le monde du design créatif. Les Ateliers Adeline Rispal viennent de remporter deux prix pour les Cités des climats et vins de Bourgogne. Ils sont Silver Winner dans les catégories Design d’intérieur – Expositions, pavillons & expositions et Design d’intérieur – Musée.
Un seul mot : Chapeau bas !
Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne
Ateliers Adeline Rispal
Cités des climats et vins de Bourgogne
1 bis, rue de Chichée 89800 Chablis
et
520, av. Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 71000 Mâcon
Atelier Correia Architectes et Associés
RBC Architecture
ACL Architecte
266, rue de Bourgogne
71680 Crêches-sur-Saône
Tél. : +33 (0)3 85 32 90 65

Je Vœux…
Commander

Franprix boosté par Oxygène

La sélection Material Bank du numéro 56 de NDA