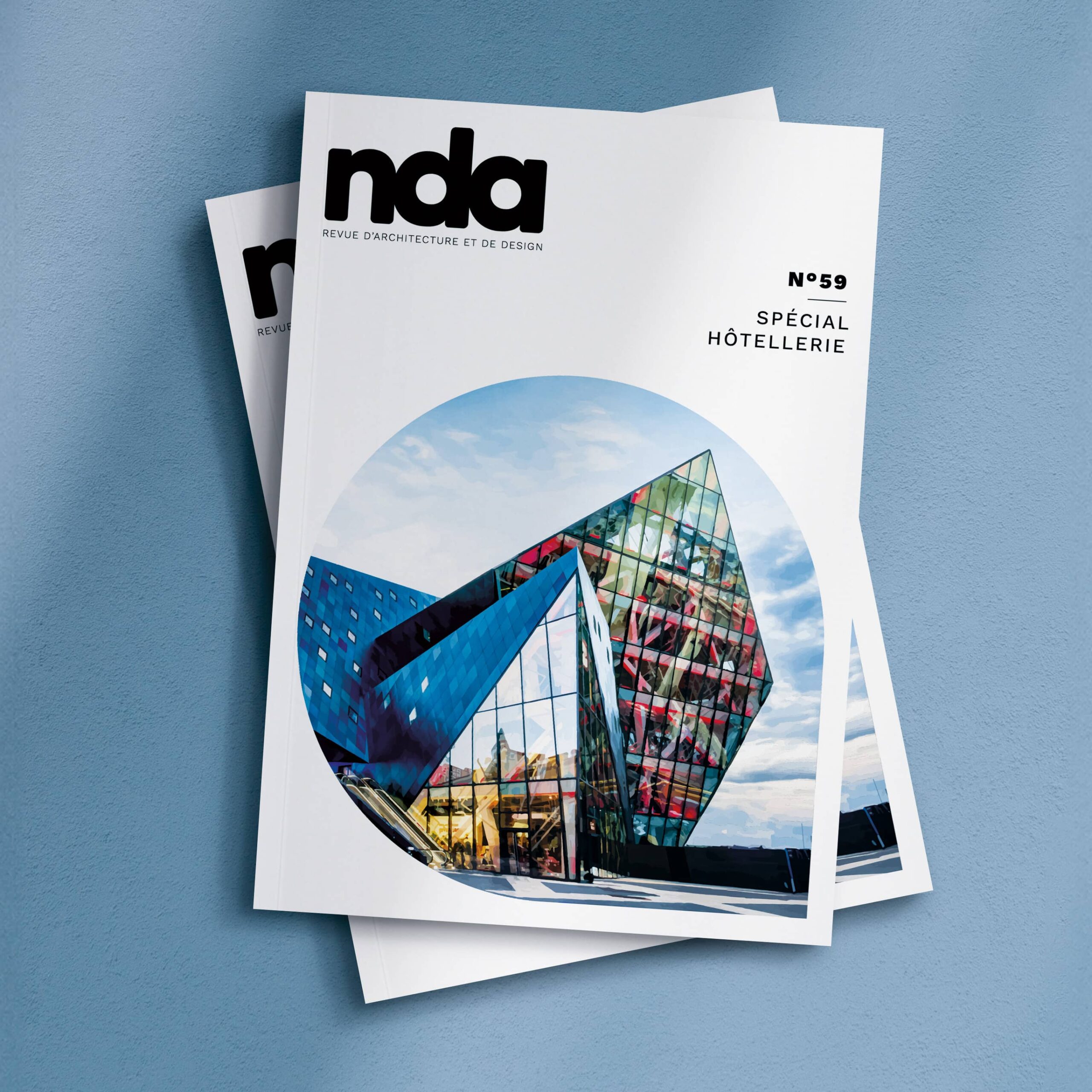Les clés des bureaux d’aujourd’hui et de demain

Pour comprendre le tourbillon de la vie et des nouveaux bouleversements, il est indéniable de connaître toutes les évolutions. En comprenant les comportements, on détient tous les codes pour une meilleure lisibilité.
En fait, des études, par exemple dans le secteur tertiaire, nous permettent de mieux cerner les attentes des utilisateurs mais aussi les transitions vers un nouvelle architecture. C’est ce que nous avons toujours appelé, dans Nda, l’architecture comportementale.
Comprendre pour mieux faire.
Deux acteurs du secteur tertiaire pour lesquels l’homme est toujours au cœur des préoccupations. Le premier, Yemanja, aménage des bureaux personnalisés en plaçant les enjeux humains au premier plan. Le second, Comme on travaille, est un cabinet conseil dédié à l’accompagnement humain des projets tertiaires. Yemanja et Comme on travaille ont réalisé une enquête auprès d’une centaine d’entreprises ayant récemment effectué un réaménagement post-Covid.
Croissance et réorganisation.
La croissance et la réorganisation des espaces sont le déclencheur principal pour un réaménagement des bureaux. Il s’agit d’intégrer les nouveaux effectifs dans la société parce que celle-ci se développe, ou lors d’un regroupement de sites. Ce facteur est plus important que de rénover un bâtiment vieillissant (dans 29 % des cas) ou de déménager pour une meilleure localisation (11 %). Autre critère poussant à un réaménagement des espaces, avec la montée fulgurante du télétravail depuis ces dernières années, il est important d’encourager les collaborateurs à venir au bureau (50 %).
Le bureau améliore l’identité de la société. Lors du résultat final, 83 % des sociétés interrogées jugent que le projet est réussi. 28 % d’entre elles estiment qu’il va même au-delà des objectifs initiaux.
- © Jonathan Moyal
- © Jonathan Moyal
- © Jonathan Moyal
Intérêt et image de la marque.
Le fait de réaménager ses locaux est fédérateur et même enorgueillit les sociétés. 94 % disent avoir donné envie de revenir au bureau après leur projet. Pour 92 %, le bureau est devenu plus utile après son réaménagement. Pour 84 %, il accentue le bien-être des équipes, et pour 91 %, l’image de l’entreprise. Pour résumer, 93 % estiment avoir amélioré leur marque employeur post-réaménagement.
Point crucial d’un projet : la salle de réunion.
Pour 75 %, il manquait des salles de réunion dans leur établissement. Le travail est devenu hybride et il a fallu revoir les espaces et leurs configurations. Les salles de réunion ont été repensées. 79 % des projets ont augmenté leur nombre. 64 % ont amélioré leurs branchements et équipements IT. Lors des réaménagements, 59 % ont mis l’accent sur la personnalisation, la décoration et l’ambiance, et 56 % ont privilégié la qualité et le choix du mobilier ergonomique.
Le fil rouge : la convivialité.
Beaucoup déploraient le manque de convivialité dans leurs bureaux (72 %). Lorsqu’ils en avaient, ces derniers n’étaient pas fonctionnels ni confortables (49 %). Le côté chaleureux manquait pour 41 %, ou ne représentaient pas suffisamment l’entreprise pour 33 %.
Par conséquent, les grands espaces sont créés. Ils passent de 67 % à 95 % et les coins café de 33 % à 68 % depuis ces dernières années. Quant aux espaces dédiés à la sieste, ils ne se développent plus autant (de 19 % à 26 %). Les lieux pour le sport restent stables (11 %). Ces évolutions chiffrées démontrent que le bien-être au bureau a changé. L’attention est portée aux lieux informels créant du lien et de la socialisation. Alors que les espaces collaboratifs sont en plein essor, des lieux de silence et de concentration sont aussi très demandés. On voit apparaître les bibliothèques (de 0 % à 21 %).
- © Jonathan Moyal
- © Jonathan Moyal
- © Jonathan Moyal
Place au flex office.
Le télétravail a chamboulé le fonctionnement et l’organisation d’un bureau. Pour 62 %, on notait un manque de places disponibles, et pour 35 % le confort du poste de travail était à revoir, avant un excès de postes dû au télétravail (14 %). Le flex office a depuis le vent en poupe. Il est de plus en plus répandu (un projet sur deux). Le principe le plus fédérateur est « la zone d’équipe souple », à savoir que l’on peut s’installer partout, même en dehors de sa zone d’équipe. Le clean desk séduit également (45 %). Grâce au fait d’avoir suffisamment de places disponibles, le collaborateur peut être sûr de retrouver la même place d’un jour à l’autre.
Pour les sociétés qui n’ont pas retenu le flex office, leurs raisons étaient que les habitudes de travail n’étaient pas compatibles (47 %). Pour 26 % d’entre elles, le flex office était un risque de voir se dégrader les conditions de travail. Le flex office peut ne pas être adopté quand la configuration des lieux n’y est pas favorable ou aussi par un refus de la direction générale. Toutefois, l’option d’un passage ultérieur au flex office peut être envisagé lors de la conception d’un projet de réaménagement.
Pour conclure, Marie Vaillant, co-fondatrice de Yemanja, précise que le bureau, en plus d’être un lieu, est un vecteur de sens, un espace où les idées prennent forme et où la culture d’entreprise s’épanouit. Quant à Camille Rabineau, co-fondatrice de Comme on travaille, le bureau post-Covid est une recherche d’équilibre entre optimisation des mètres carrés et confort des surfaces, meilleure satisfaction des besoins collectifs et des besoins personnels.
Cette enquête nous permet de comprendre les nouveaux codes d’aménagements de bureaux. Merci pour ce livre blanc.
Yemanja
47, boulevard Saint-Martin
75003 Paris
Tél. : +33 (0)6 71 07 04 79
Comme on travaille
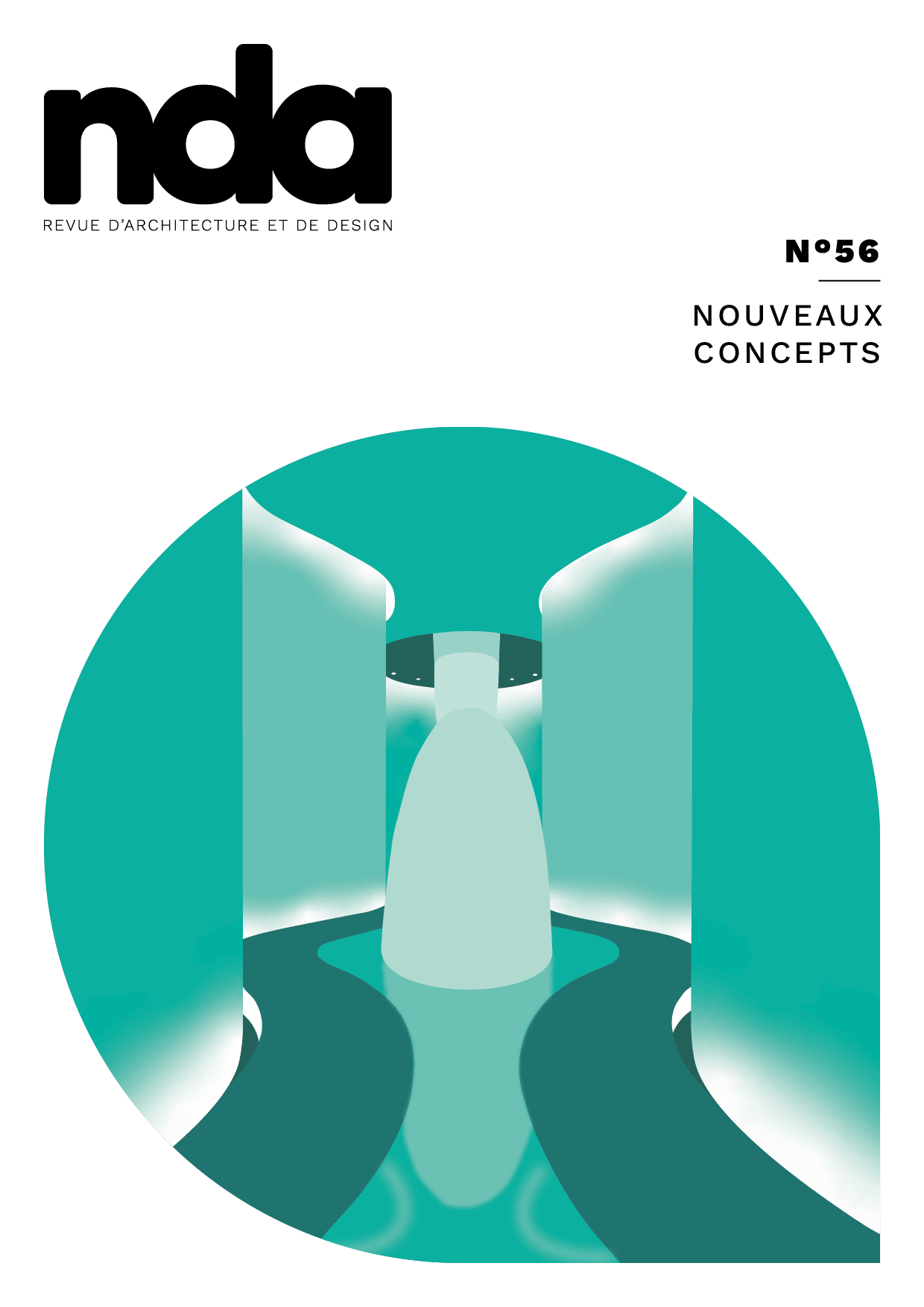
Nouveaux concepts
Commander
Numéro en cours
Nº63
Spécial Santé, Bien-être, Bien-vivre

Novembre — Décembre 2025 — Janvier 2026
Découvrir

Baléidoscope angevin

L’étincelant complexe sportif du Coum