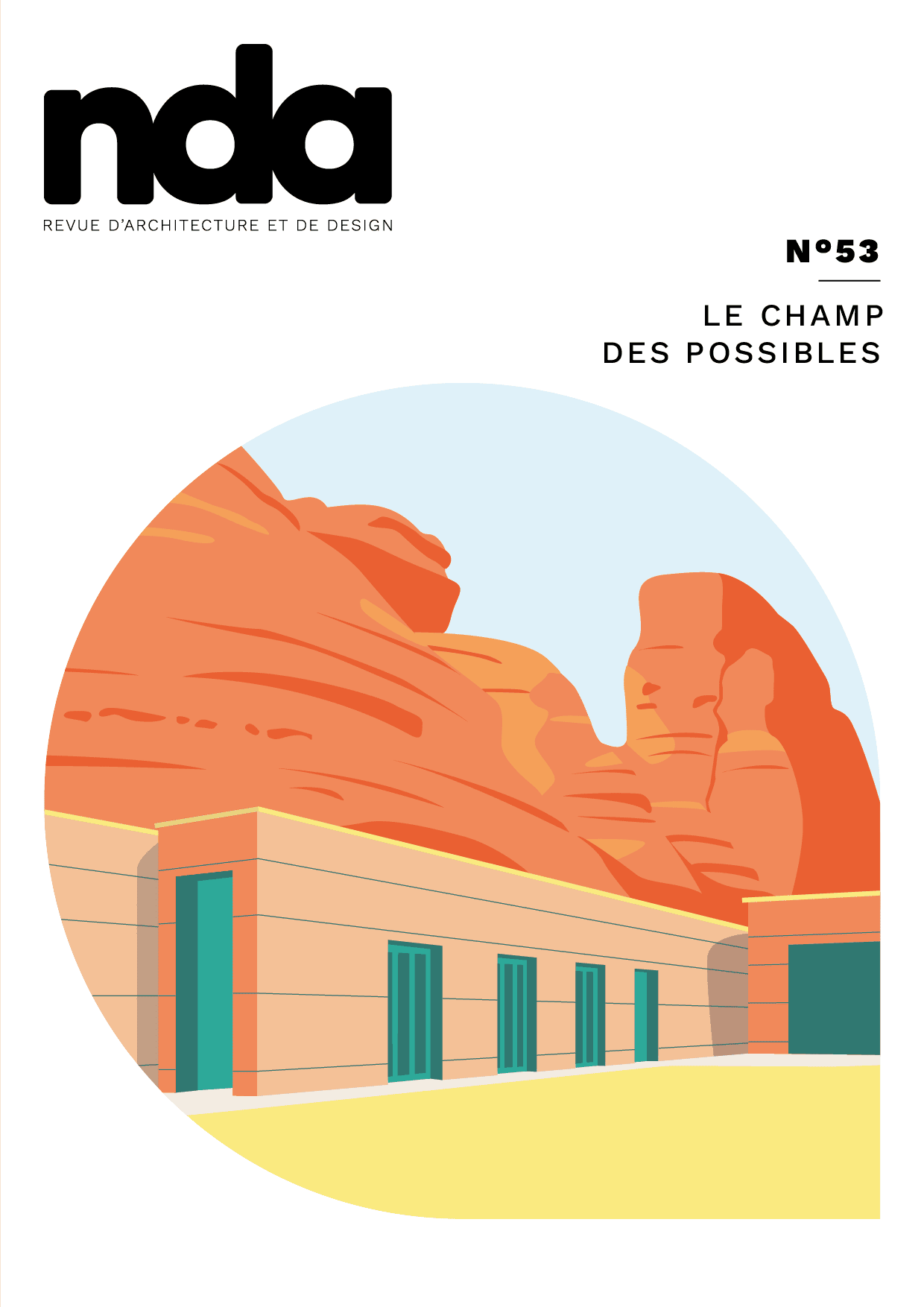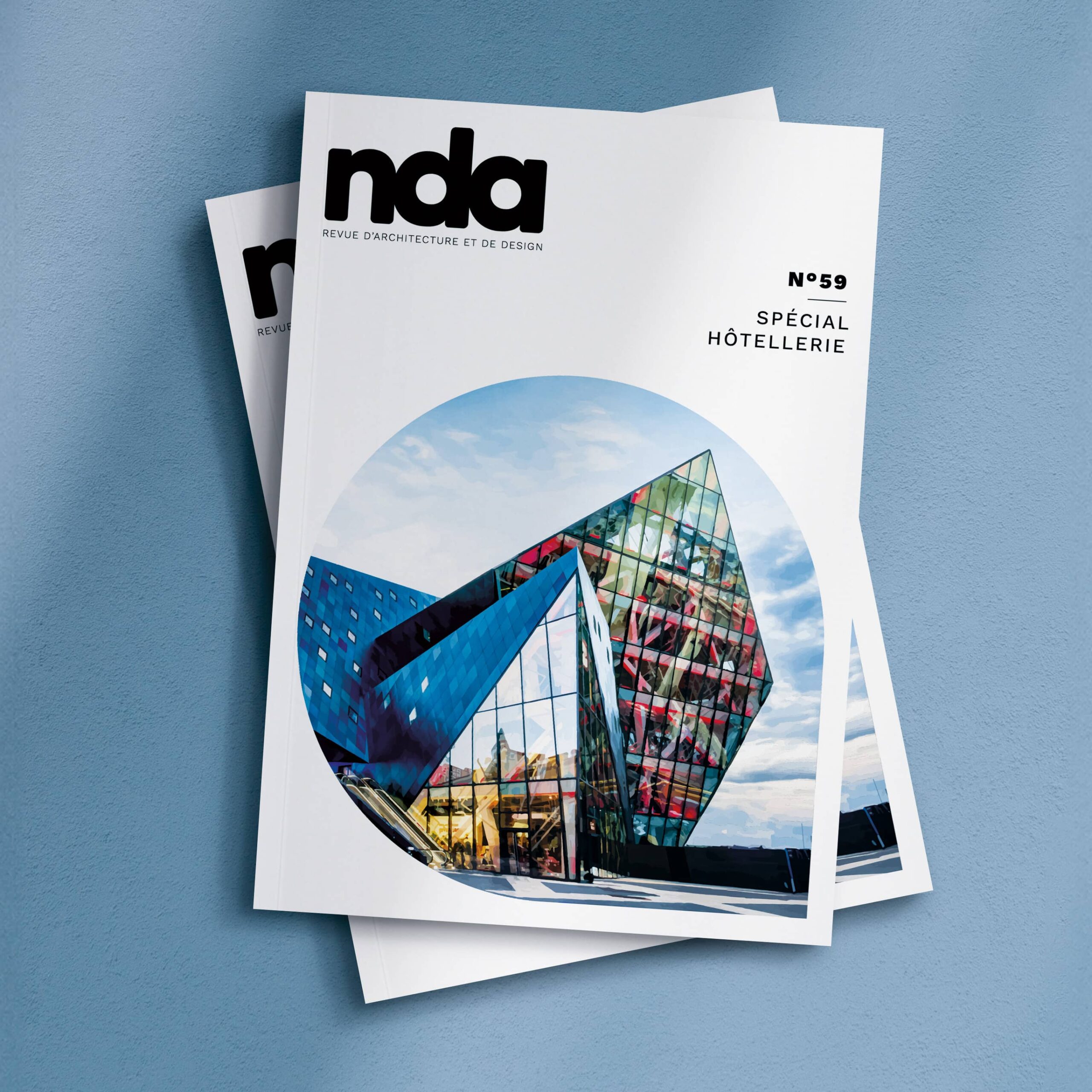Architecture, l'esprit du lieu
Siena Paris : un avant-goût de Toscane
Par Sipane Hoh, le 23 août 2024
C’est le nouveau restaurant parisien qui attire la foule. Siena Paris, un lieu majestueux aménagé et décoré par Sophie Lacroix, la fondatrice de Bureau Lacroix. Deux étages, une enfilade de petits, moyens et grands espaces, le tout conçu avec finesse pour un résultat empreint d’une grande sensibilité. Des couleurs chaudes, des teintes terre de Sienne, des fresques inspirées des palais de la Renaissance, des alcôves, mais aussi du velours sur les bancs, du mobilier jusqu’aux petits détails, tout nous rappelle la Toscane. Siena porte bien son nom, un restaurant où le visiteur déguste des plats italiens et, grâce au décor, entame un voyage immobile, direction l’Italie. Le restaurant, possède une superficie de 900 m², il se trouve dans le Ier arrondissement parisien, au 35, place du Marché Saint-Honoré, un emplacement stratégique où la clientèle touristique se mêle aux initiés. Sophie Lacroix, encore étudiante de Penninghen, qui a été distinguée en 2017 à la Paris Design Week « Nouveau talent du design », devenue depuis une talentueuse architecte d’intérieur, a engendré au sein de Siena une décoration subtile où, dès l’entrée, le visiteur découvre avec joie les premières fresques au décor floral des artistes peintres Rosatelier. Au rez-de-chaussée, l’ensemble se divise en trois espaces, dont deux pièces discrètes et tamisées qui ceignent la pièce principale. De là, nous pouvons emprunter un couloir qui nous ramène à un espace de restauration situé sous une verrière. La surprise est immense : qui aurait pu croire à une telle démesure ? À l’instar d’une forêt, l’espace se caractérise par une envolée d’oiseaux en laiton brossé, fabriquée en France par Créalum’in, qui vient compléter des bas-reliefs végétaux. Ces derniers font un joli clin d’œil à d’autres motifs végétaux dessinés sur les murs. Au sol, la moquette Pavot – décor iconique de la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil –, déclinée en terracotta et or, complète cet univers où luminosité et exubérance sont au rendez-vous. Nous sommes bel et bien quelque part entre la Toscane et Paris. Une moquette aux couleurs chaudes, des semblants de fenêtres en miroir vieilli, des banquettes frangées, des chaises en velours et des fauteuils en cannage, tous conçus avec soin par Bureau Lacroix. De surprise en surprise. Continuons vers le premier étage, à travers des escaliers où trône sur leur battant une énorme sculpture de girafe de couleur sombre, mutée en mascotte des lieux. Arrivée en haut, découvrons ensemble un espace plus intime, une salle dinatoire privée pouvant accueillir une grande tablée. À Siena, les surprises se succèdent et ne se ressemblent point. Un couloir en miroir où s’égare le regard nous amène vers un autre espace où se trouve un bar. Même si plusieurs éléments restent les mêmes, c’est un univers différent qui s’offre à nos yeux, un monde nocturne aux lumières tamisées où les célébrités peuvent s’offrir un dîner, à l’abri des regards. Un coup de cœur pour la signalétique, aussi discrète que révélatrice, conçue à l’occasion par Bureau Lacroix, et soulignons que, grâce à l’expertise de MVP Production qui assure également le déroulement du chantier, les scénarios de son et de lumière ainsi que l’acoustique