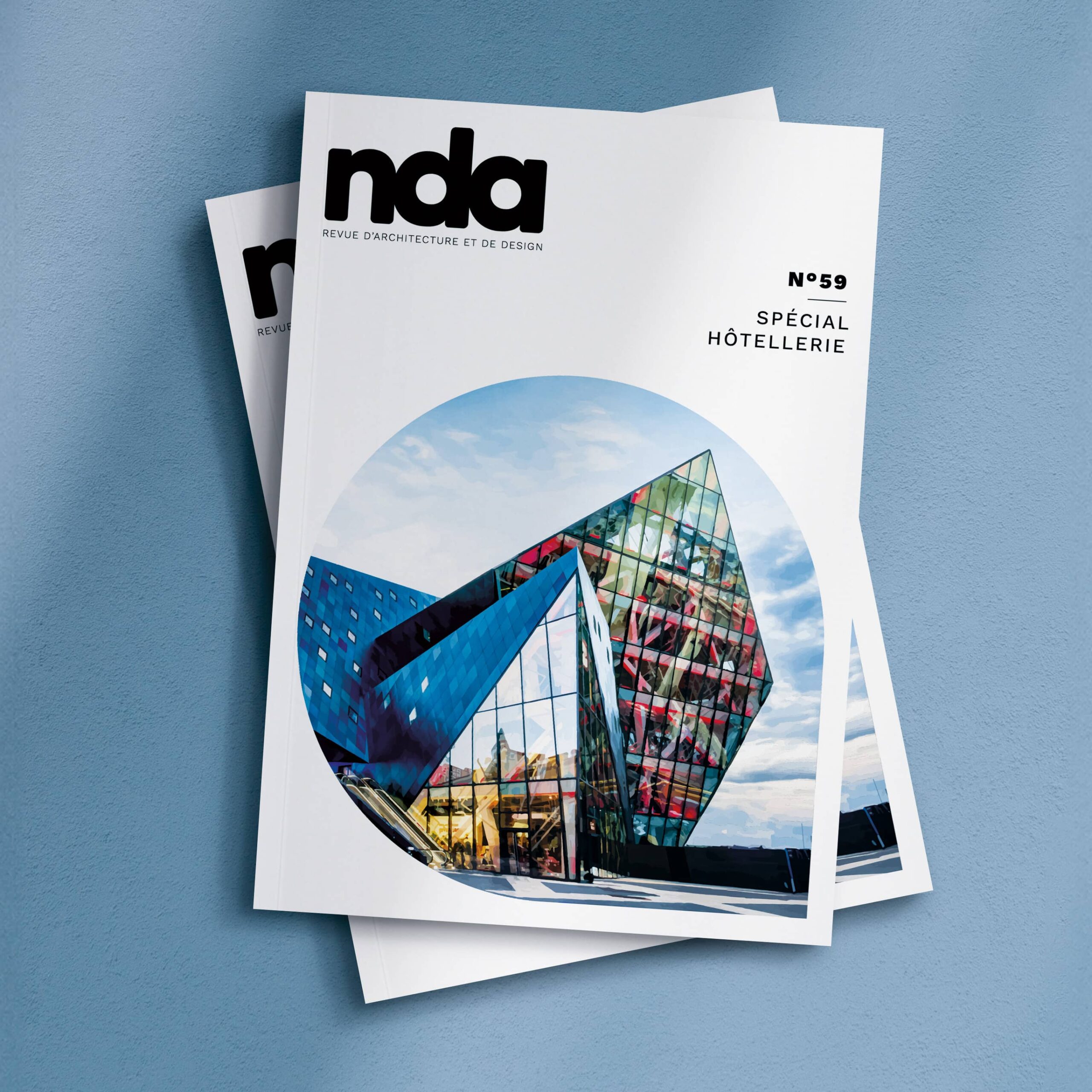CAB ou l’art de vivre… l’art

La fondation CAB de Saint-Paul-de-Vence héberge une vingtaine d’œuvres d’art minimal et conceptuel du collectionneur flamand Hubert Bonnet, des artistes en résidence, des expositions temporaires et… quelques amateurs d’art(s) de vivre.
À mi-chemin entre La Colombe d’or et la Fondation Maeght, ce satellite de la fondation CAB bruxelloise synthétise leur vocation respective : promouvoir l’art tout en sustentant et logeant ses visiteurs. Rénové par Charles Zana, le superbe bâtiment des années 1950 offre désormais plusieurs espaces d’exposition, une librairie-boutique, un restaurant, cinq chambres d’hôtes dont une investissant une maison démontable de Jean Prouvé.
De la finance à l’art.
Spécialisé dans la rénovation de l’immobilier de luxe, Hubert Bonnet n’est pas le premier homme d’affaires collectionneur. Vivant depuis deux décennies à Verbier, en Suisse, pour mieux assumer son amour de la montagne, ce quinquagénaire passionné de mathématiques et d’architecture des années 1930 aux seventies s’est ainsi laissé séduire par la radicalité du courant minimal et conceptuel belge et international. Lorsqu’il a décidé de montrer sa collection, il a imaginé une fondation à but non lucratif conçue comme une plateforme d’échanges autour de ce courant artistique. Pour ce faire, il a investi en 2012 un ancien entrepôt de 800 m2 de style Art déco, construit dans les années 1930 pour l’industrie minière non loin du cadre idyllique des étangs d’Ixelles. Sous l’étonnante voûte en charpente métallique, il organise également chaque année deux expositions majeures dont les œuvres proviennent d’autres institutions (collections privées, musées et galeries) ou ont été créées in situ par des artistes invités.
- Felice Varini, Four interlocking Circular Crown (2020), Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence. © Antoine Lippens
- Guest room The Three, Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence. © Antoine Lippens
- Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence. © Antoine Lippens
Neuf ans plus tard, il se rend acquéreur de la très belle maison à l’architecture moderniste très fifties ayant abrité à Saint-Paul-de-Vence la galerie d’art contemporain figuratif de son compatriote belge Guy Pieters.
Fondation CAB
5766, chemin des Trious
06570 Saint-Paul-de-Vence
Tél. : +33 (0)4 92 11 24 49
Charles Zana
13, rue de Seine
75006 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 48 05 25
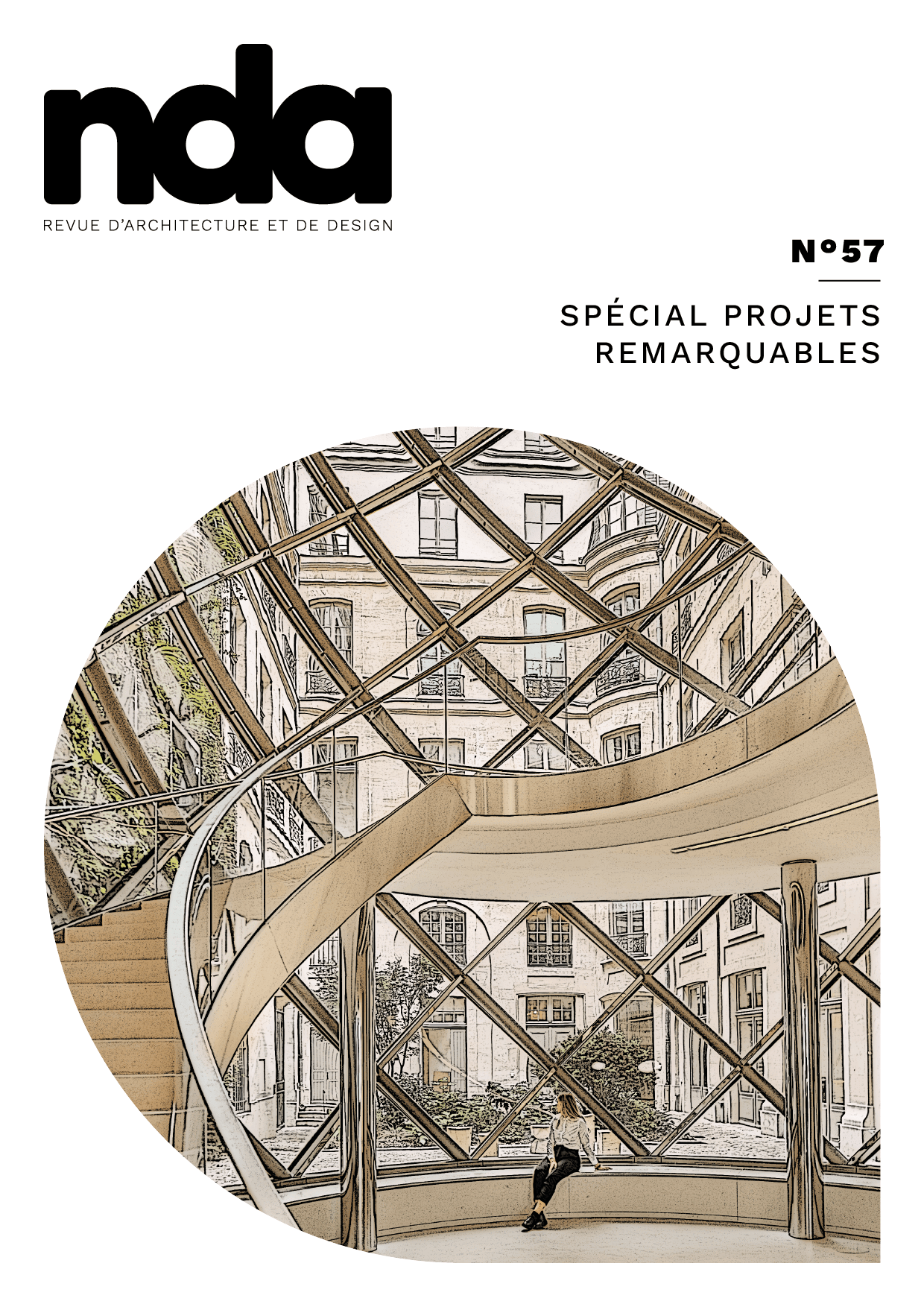
Projets remarquables
Commander
Numéro en cours
Nº63
Spécial Santé, Bien-être, Bien-vivre

Novembre — Décembre 2025 — Janvier 2026
Découvrir

Hôtel de Pourtalès, Paris

La sélection Material Bank du numéro 59 de NDA