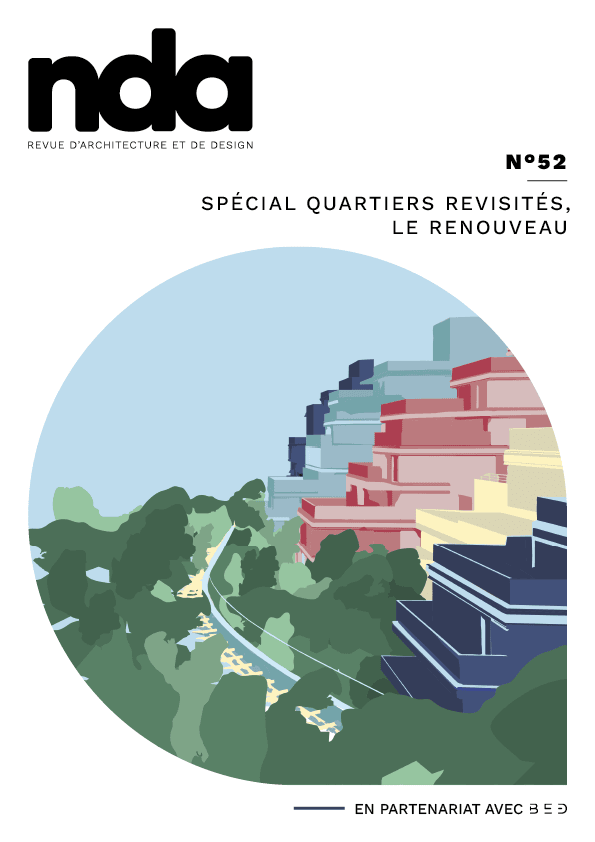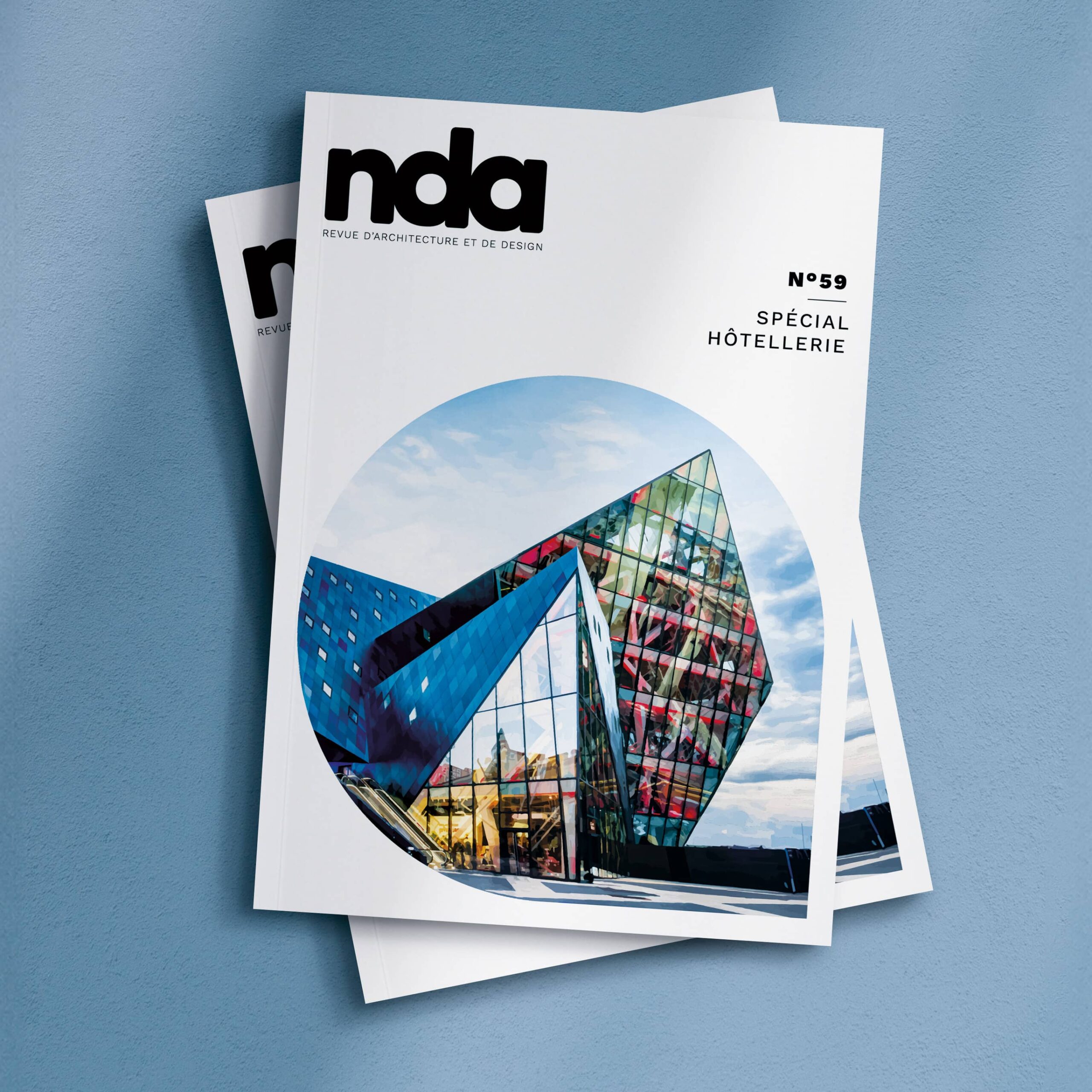Dans le labyrinthe du design 80

Expositions et livres se bousculent pour célébrer la décennie qui a redéfini le design, de Nestor Perkal, Philippe Stark à Martin Szekely… Retour sur des carambolages foisonnants.
Il y a toujours eu de sempiternels engouements pour le passé ! La nostalgie cette fois s’empare des années quatre-vingt, temps revisités comme légers, démocratiques, libres. Elles ont certes marqué la fin des dogmes idéologiques, ouvrant à la «complexité» du monde théorisée par Edgar Morin. C’est vrai qu’elles ont été exubérantes et festives ! Cependant ces années furent aussi mal aimées : années fric, frime, clip, pub, look, coke… Années fastes aussi de l’État partenaire de la culture, mais apparition du relativisme culturel, de l’individualisme, du libéralisme, de l’ultra-starisation, de la communication. «On nous Claudia Schiffer» chantera plus tard Souchon en guise de bilan en 1993. Cet «âge d’or» fut en plus percuté par le Sida, les SDF, Tchernobyl… Mais en 2022, période de toutes les sobriétés et angoisses, ces eigthies sont revues comme une extravagante embellie qui fait envie, chantée par Chagrin d’amour : «Chacun fait, fait, fait, C’qui lui plaît, plaît, plaît…»
C’est particulièrement du côté des musées, galeries de design et de l’édition que le design fait un grand retour. Car à l’époque, redéfini, il explose. Le mot est enfin utilisé en France. Il est représenté par une star populaire, Philippe Starck, l’objet aussi quotidien que sa brosse à dents s’arrache en 1989 1.
Nestor Perkal, un éclaireur
Passons d’abord à Bordeaux. Au Musée des Arts Décoratifs (Madd), Nestor Perkal a été présenté en « éclaireur » jusqu’au 8 janvier, lui qui a si bien saisi cette période 2. Et cela tombe à pic, une première biographie lui est consacrée chez Norma 3 (voir encadré). Sa naissance en 1951 en Argentine, sa formation d’architecte à Buenos Aires, sa passion pour l’art cinétique, ses voyages d’Amérique du Sud à l’Italie… ont esquissé l’identité de l’homme qui arrive à Paris en 1982. «Éclaireur» donc car dès son arrivée, il expose, dans ses galeries près de Beaubourg et puis du Marais, les meubles et objets du mouvement milanais Memphis, puis ceux de jeunes créateurs comme Javier Mariscal, Nathalie Du Pasquier, George Sowden… L’exposition est introduite par ce talent de découvreur.
Se dressent ensuite quelques-uns de ses meubles noirs, dont le bureau Azul qui fera reconnaître son travail de designer. Avec les pièces réjouissantes d’Algorithme, maison d’édition créée en 1987 autour du métal argenté, c’est en directeur artistique qu’il convie d’autres designers à innover. L’exposition opère un choix rigoureux d’œuvres parlantes. À chaque fois, une nouvelle pièce confirme la passion de Perkal pour les techniques artisanales. Il se penche sur bien des matériaux – cuir, verre, bois, tissus, miroir. En 1992, il collabore avec Lou Fagotin pour la collection Les Rivières. Où il ravive la tradition des feuillardiers, de la Creuse au Périgord, en clouant entre elles de simples branches de châtaignier. Toujours passeur, à Limoges, il dirige le CRAFT (Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre) de 1992 jusqu’en 2009. Avec lui, artistes et designers vont recuire la céramique autrement. Comme le spectaculaire But de foot en porcelaine de Wim Delvoye.

Nestor Perkal, lampes et pièces Algorithme. © Madd / F. Deval.
Aux murs, des images (pas assez !) rendent compte de sa clairvoyance à appréhender l’espace. Dès 1985, il aménage un appartement sous les toits pour un jeune homme. Il re-sculpte les lieux, caractérise chaque pièce par des couleurs vives structurantes. Il joue de textures différentes, de miroirs qui reflètent « l’imagination d’un art de vivre ». Renforcée par la passion pour l’art et la photographie que ce concepteur-collectionneur sait instiller.
À l’extrémité de la salle d’exposition, des œuvres des années deux mille. Il va alors voyager, se recentrer sur lui. En osmose avec l’entreprise italienne de cuirs, Oscarmashera, il fait bondir des caballito qui évoquent le cheval d’arçons. Toute une gamme de sièges en métal et peau, inspirés des selles de chevaux argentins. Voilà qu’il retrouve son bon trot, rythmé par ses métaphores.
Pourrait apparaître un grand saut entre ses premières et récentes pièces. S’il n’y avait l’habitacle L’Immigrant (1997). Côté face, des tôles ondulées colorées évoquant la Bocca, quartier pauvre de Buenos-Aires. Derrière, des vases somptueux en verre réalisés au Cirva (Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques) de Marseille. Un manifeste, un autoportrait qui, en mettant dos à dos les matériaux humbles d’un artisanat indigène et le faste de contenants conçus dans l’aisance, n’oppose pas ces deux formes créatives. Perkal les met en lumière, souligne les contradictions économiques et sociales du monde, il saura jouer de ces oppositions avec humour.
L’exposition bordelaise démontre à quel point il sait jongler avec les rôles d’architecte, d’aménageur d’intérieur, de scénographe, de designer, de galeriste. «Je suis plus intéressé par des objets expérimentaux, préférant la recherche à la production de masse», affirme-t-il. Il représente la démarche de bien des designers indépendants, éclos dans les années quatre-vingt. Pas étonnant qu’on le retrouve à Paris, au Musée des Arts Décoratifs dans l’exposition «Années quatre-vingt, mode, design et graphisme en France», qui célèbre en grand la décennie 4.
Nestor, Jeanne, Norma et les autres
Il n’était plus sur le devant de la scène. Dans la première biographie consacrée à Nestor Perkal, la critique Jeanne Quéheillard ré-enchante ce personnage. De son écriture alerte et documentée, elle saisit les cinquante ans de créations si riches de cet architecte, à la fois scénographe et designer. Sans chronologie, au gré du plaisir, elle regarde les miroirs, récurrents comme « un ressort de construction spatiale ». Elle re-campe les habitacles, si nombreux, de lit clos en tonnelles de jardins. Les objets sont analysés comme autant de «métaphores». Est dépeinte la hardiesse des couleurs qui découpent les espaces. À travers les recherches et les ateliers, sont scrutées les relations que ce designer a tissées, lui qui a tant aimé travailler «avec les autres». Perkal, né en 1951, se reconnaît dans la nouvelle de Julio Cortazar, Casa tomata (1946), «une maison envahie d’objets qu’il faut quitter brutalement». Entre mélancolie et jouissance, de Buenos Aires à Paris, naît une biographie-mosaïque d’un déplanté juif argentin, aujourd’hui recentré au cœur des époques et du monde.

Le décorateur Pucci de Rossi. © Mad Paris.
Dans la grande Nef parisienne
Rue de Rivoli, cette rétrospective se fait d’abord à petite échelle dans les salles parallèles à la Nef. Impossible de ne pas céder à l’effet bain de jouvence, à la sensation de rupture politique et artistique. Jubilons en redécouvrant les années Tonton-Mitterand et d’Énergique-Lang. Car qui aujourd’hui critiquerait «TontonKamon», les colonnes de Büren, la pyramide de Pei au Louvre ? On se régale devant les affiches des radios libres, celles résistantes d’Alain Le Quernec telle Au début Hitler faisait rire, pour alerter de la montée du FN. Revoyons Libération et son symbole, le logo-triangle rouge dessiné par Claude Maggiori. Défilent les habillages de Canal+ d’Étienne Robial, les pubs Eram, les fantasmagories multi-couleurs de Jean-Paul Goude, le clip « T’as le look coco !» de Laroche et Valmont. En photos, en vidéos et bandes-son, on se retrouve «tous aux Halles» au Café Costes, le petit «fortin» qui sacre Starck, «ce sera beau et triste comme le buffet de la gare de Prague» ! Dans toutes les boîtes de nuit «branchées», le Palace surtout, les Bains Douches, on reluque les personnages plus qu’excentriques de ces antres à paillettes et lasers, d’Andy Warhol à Alain Pacadis. Que de carambolages ! Ils sont nettement enrichis dans le catalogue 4 qui mise sur un éclectique collage assez complet.
Dans la grande Nef, la scénographie exulte. Le designer Adrien Rovero a servi un grand tremplin (justifié) à Star-Starck, à d’autres créateurs, François Bauchet, Martin Szekely, Sylvain Dubuisson, Olivier Gagnaire, Pucci de Rossi… Ils s’entrelacent avec la mode, ces sublimes froufrous mi-innovants mi-revisiteurs de Thierry Mügler, Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa… Les emblématiques Garouste & Bonetti, duo barbare de la chaise iconique du même nom, frôlent le baroque Christian Lacroix.

Croisements baroques entre Christian Lacroix et Garouste & Bonetti,© Mad Paris
Ce qui sert particulièrement de fil multicolore à l’exposition, ce sont les galeries de design, elles ont joué un rôle essentiel de vitrines. Neotu de Gérard Dalmon et Pierre Staudenmeyer sera le lieu majeur car érudit et critique. Nestor Perkal évidemment, Yves Gastou qui révélera le Japonais Shiro Kuramata, Avant-Scène 5, la galerie de Gladys Mougin qui présentera l’Anglais Tom Dixon, En attendant les Barbares, forcément, qui remet en lumière la chaise Orque (1987) de Jean-Philippe Gleize 6.
Le Via, originale «Valorisation du mobilier d’ameublement» française en lien avec l’industrie, n’est pas oublié, il a donné cartes blanches à tant de débutants, le quatuor Totem y a présenté sa première exposition en 1981. Mais où est passée Andrée Putman, elle qui avec Ecart International a fait ressurgir Jean-Michel Frank ? Cette grande égérie novatrice aurait bien mérité un podium, elle fut si eighties, elle a importé de New York le loft dans les intérieurs.
Tous ces lieux parisiens vivants, fréquentés, ont fait émerger un design éclectique, de haute facture comme la mode, théâtral, inclassable, qui s’est donné la liberté de l’art à travers des éditions de pièces limitées. D’une diversité stylistique incroyable qui va s’inspirer de la Sécession viennoise, du classicisme, du punk, du japonisme, du néo-tout… Une boîte noire à décrypter. Ces galeries ne sont pas restées franchouillardes, elles ont aussi démontré que le design était international, qu’il y avait échanges et influences entre le Japon, l’Italie, la Grande-Bretagne, l’Espagne et sa movida… 8. On sait, ironie de l’histoire, que les créations quatre-vingt d’exception sont devenues des œuvres exagérément surcotées, loin d’un design pour tous.
Szekely, pures attentions
Dans les années quatre-vingt, beaucoup de meubles sont noirs. Cette couleur s’inspire du Japon dont les créations, de la mode au design, déferlent en France. La chaise longue Pi (82-83) de Martin Sezkely en témoigne, telle un trait calligraphique. L’apport de ce designer à la période est essentiel. Deux expositions l’ont démontré. La galerie Jousse a complété la collection Pi, avec un cendrier énorme inimaginable aujourd’hui, montré la chaise moins connue Hérouville pour le foyer de la Comédie de Caen. Szekely dessine encore, sculpte, il adoucit les angles de rondeurs. Mêmes courbes à la galerie Mercier & Associés, avec les chauffeuses blanches Marie-France, «attentionnées», une commande de l’architecte Marie-France Schneider, comme le miroir Piège à Louvre ou l’Escalier en acier passivé. Là, le designer dessine l’espace sans être sur-envahissant. «Je savais, dit Marie-France Schneider, qu’avec lui il n’y aurait pas de violence faite à la personne». Ni aux visiteurs qui peuvent savourer les pleins et les vides d’une architecture intérieure finement mise en scène.

Stand du VIA, dont meubles Totem, sur fond d’affiches politiques. © Mad Paris
Mais «Qu’y avait-il, qu’il n’y a plus, à la fin des années soixante-dix et tout début des années quatre-vingt ?» s’interrogeait Claude Eveno en 2019 7. Sa réponse : une «fantaisie» qui a inspiré Martine Bedin pour Super en 1981, «un lampadaire à roulettes qui file sur le parquet !». Ces objets sont devenus des objets de mémoire, comme dans la Recherche de Proust, dont on célèbre en même temps le centenaire de la mort. L’Italien Alessandro Mendini n’a-t-il pas assis son fauteuil Proust en 1978, une nébuleuse pointilliste évoquant la réminiscence ?
Mais le choix de l’exposition de s’appuyer sur les galeries parisiennes est-il si pertinent ! Il sectorise design et mode réunis dans tous leurs fastes – ces deux arts appliqués sont certes le créneau du musée – mais en les coupant du graphisme, de la photographie, de la musique, du cinéma, du théâtre, de la danse, tous renaissants à l’époque. Car ces années ont été celles d’un décloisonnement fertile entre les disciplines, Gauthier danse avec Découflé. Par ailleurs, ce parti pris façon «period room» tombe dans l’excès du spectaculaire. Il aurait été plus drôle de mélanger luxe et quotidien. Ils sont bien relégués les minitels et baladeurs gris, les rollers Boum et le TGV, les néons fluos et les salopettes jean, qui font tant datation ! Le design industriel était en effet coupé de ce mouvement arty, regardé comme élitiste, mais les gens ne se gênaient pas pour tout entremêler. Et Pierre Paulin, Roger Tallon, Marc Berthier… œuvraient, des fers à repasser aux rasoirs.
À la sortie de l’exposition dans un «Je t’aime moi non plus» typique de la période Gainsbourg / Gainsbarre, nombre de visiteurs, visiteuses étaient perplexes, voire «tristes». L’exercice est difficile, un musée n’est qu’un musée, muséal. Comment faire revivre les nuits mythiques du Palace, le nightclubbing auquel le design a offert les plus étonnants décors. Dans le catalogue de l’exposition, Pascal Ory 4 pose la question : «Les années quatre-vingt ont-elles existé ?» En effet, la rétrospective décennale est arbitraire, ces années n’auraient-elles pas commencé avec le punk en 1977-1978 ? Elles pourraient se clore en 1986 avec les marasmes du Sida et de Tchernobyl ! On ne sait plus, comme Louise, l’héroïne mélancolique du film « La Nuit de la Pleine Lune » (1984) d’Éric Rohmer, qui hésite entre la modernité grise quatre-vingt et le baroque coloré néo-tout. Écartelée entre des soirées endiablées et son mal de vivre individuel.
La décennie du trompe-l’œil s’achève avec des feux d’artifice illusionnistes, jouissifs sur le moment. Avec le bon Good unanimiste du Bicentenaire de la Révolution française, avec la chute radieuse du Mur de Berlin. Mais c’est le massacre de la Place Tian’anmen à Pékin qui a fait redescendre, préfigurant une nouvelle ère de la géopolitique. Rassurons-nous, les années quatre-vingt n’auront qu’un temps, les quatre-vingt-dix pointent déjà leurs réseaux et plates-formes numériques. Et à très vite les deux mille versus Belle Époque 1900 !
1. Musée Carnavalet, 75003, « Philippe Starck, de Paris à Paris », exposition du 29 mars au 27 août 2023. www.carnavaletparis.fr
2. Madd Bordeaux, www.madd-bordeaux.fr
3. « Nestor Perkal, architecte, scénographe, designer », Jeanne Quéheillard, octobre 2022, Norma, 55 euros.
4. Mad de Paris, jusqu’en avril 2023. Catalogue Années quatre-vingt, mode, design et graphisme en France, édition Mad, octobre 2022, 49 euros. www.madparis.fr
5. « Les années quatre-vingt d’Avant-Scène », exposition jusqu’au 16 mars 2023, www.avantscene.fr
6. En attendant les Barbares, quatre décennies de design, Anne Bony, éditions du Regard, septembre 2022, 45 euros.
7. Objets nos amis, une conversation, Martine Bedin & Claude Eveno, éditions éoliennes, 2017, 17 euros.
8. Créateurs des années quatre-vingt-quatre-vingt-dix, mobilier et aménagements, vision internationale de Guy Bloch-Champfort et Patrick Favardin, éditions Norma, novembre 2022, 65 euros.

Ven(t)danges bretonnes

Lab 157 le bureau revisité et 100% durable